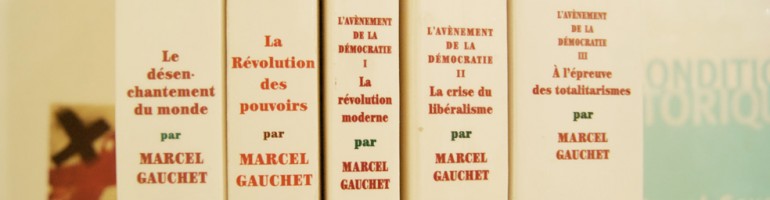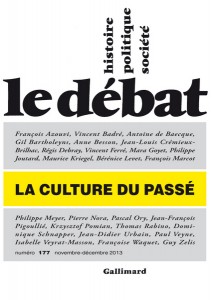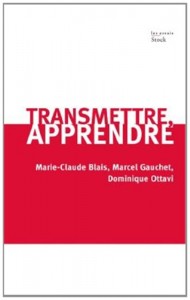Marcel Gauchet a introduit les Rencontres de Sophie qui avaient pour thème cette année la liberté par une leçon inaugurale intitulée « Liberté et pouvoir » le jeudi 13 février 2014 à 12h30 au Lieu unique à Nantes (TU-Nantes).
L’enregistrement vidéo de la conférence est disponible.
Il paraissait aller de soi que la liberté des personnes se prolongeait dans le pouvoir des peuples. L’évolution des démocraties libérales impose à cet égard une révision déchirante. Et si les libertés avaient pour effet de nous priver de pouvoir ?
« La liberté individuelle a pris pour de bon le statut de principe organisateur suprême dans toute l’étendue de ses conséquences : liberté des accords interindividuels, liberté personnelle, liberté d’entreprendre, liberté de créer un journal, une télévision, un parti politique ou une association. Bref, liberté des acteurs de la société civile de s’organiser comme ils l’entendent. Nous ne pouvons penser autrement. Dans l’autre sens, il n’y a plus grand monde pour croire en la capacité de l’Etat à mettre une société en ordre par en haut et à l’administrer de part en part rationnellement. Cet horizon a quitté le champ du pensable tout comme la foi dans la capacité de la puissance publique d’organiser la vie économique et de la gérer de manière optimale dans l’intérêt collectif. C’est une perspective qui a cessé d’être croyable alors qu’elle avait soulevé d’immenses espoirs en une société meilleure pendant des décennies. Evénement extraordinaire qui change ce que nous pouvons penser de notre société et de la manière la meilleure de l’aménager. En ce sens-là, et c’est là qu’est la nouveauté essentielle de notre situation intellectuelle et morale ou de notre conjoncture idéologique, nous sommes tous devenus, que nous le voulions ou non, que nous le sachions ou non, nous sommes tous libéraux. Entendons qu’il n’existe plus en réalité que, outre les libéraux avoués, des conservateurs libéraux ou des socialistes libéraux. Ils peuvent très bien ne pas le savoir mais ils le sont malgré eux et l’épreuve des faits nous permet de le vérifier car premièrement, les clivages idéologiques n’ont aucunement disparu pour autant. Et secondement, le problème d’interprétation du fait libéral et de la juste place à lui donner est plus vivant et plus aigu que jamais. Ce dont nous nous apercevons chaque jour un peu mieux, la crise financière de 2008 ayant été à cet égard un accélérateur de clarification décisif, c’est que si les libéraux ont été les fers de lance de la critique de l’ancien monde qui a effectivement sombré, celui de l’économie administrée et du surplomb étatique, ils sont très loin d’avoir la réponse aux questions que soulève le gouvernement du nouveau monde issu de cette inflexion. Les libéraux ont tiré un avantage formidable dans un premier temps de ce triomphe du fait libéral qui leur a donné raison dans le principe. Mais leur démarche au fur et à mesure qu’elle s’est déployée n’a cessé de révéler des failles béantes dans un second temps qui relancent la carrière de leurs concurrents. D’où la cacophonie et les contradictions ambiantes. Sans doute sommes-nous à un moment crucial de décantation idéologique destiné à mettre en place un nouveau système de repères politiques comme celui qui s’était installé dans la première moitié du 19ème siècle. Le point acquis, c’est le caractère indépassable et structurel du fait libéral dans nos sociétés. Nos sociétés sont de structure libérale et il est essentiel de comprendre pourquoi. Mais le point second qu’il faut ajouter au premier, ce sont les limites du libéralisme idéologique. Pour le résumer en termes populaires ou familiers, les nationalisations, cela ne marche pas. Soit. Mais le marché, cela ne marche pas non plus. Car ce fait structurel, qui est un fait problématique, exige un travail de réglage et d’organisation auquel le libéralisme d’aujourd’hui n’a pas la réponse, un travail dont il ne fournit pas la recette que ce soit au niveau le plus élevé du libre-échange global ou au niveau du fonctionnement de n’importe quel micromarché. Mais le problème va bien au-delà de l’économie. Surtout, désenclavons le problème du domaine de l’économie. Il concerne le fonctionnement d’ensemble de nos sociétés au stade atteint parleur libéralisation qui justifie de parler de néolibéralisme. Je n’ai pas le temps ici d’accorder au sujet la place qu’il mériterait. C’est le degré de libéralisation qui justifie à un moment donné de parler de néolibéralisme par rapport au libéralisme classique. Pour le dire en deux mots : nos démocraties ne peuvent pas être seulement libérales. Elles doivent aussi être démocratiques, c’est-à-dire capables d’organiser un authentique pouvoir en commun. C’est ici que se situe le ressort de la crise qui frappe nos démocraties, une crise qui résulte d’une accentuation unilatérale de leur dimension libérale. D’une manière générale, le libéralisme, à l’instar de n’importe quelle autre idéologie, tend à l’unilatéralisme. Il est aveugle en particulier au rôle nécessaire du politique dans le fonctionnement de nos sociétés. Il ne voit pas que plus de liberté pour la société et plus de liberté pour les individus dans la société vont nécessairement de pair avec plus d’Etat. Pas le même Etat, pas un Etat d’autorité surplombant la collectivité mais un Etat infrastructurel pourrait-on dire, créant les conditions de la coexistence et en mesure d’impulser les orientations collectives. Au bout de la libéralisation extrême, nous sommes en train d’en faire l’épreuve, il y a l’impuissance collective. Si nos démocraties se réduisent à la coexistence des libertés au sein d’une société de marché politique, elles entrent en contradiction avec leur principe fondamental qui est l’autogouvernement. La liberté de chacun perd son sens dans l’impouvoir général. Une liberté sans pouvoir est tout simplement dérisoire. Peut-être fallait-il en faire l’expérience pour que nous entreprenions de repenser la liberté. La liberté n’est pas selon l’idée spontanée que nous sommes portés à nous en former que contradiction avec le pouvoir. Elle a aussi besoin du pouvoir pour se réaliser. C’est dans la composition de ces deux exigences, problème autant philosophique que pratique, que se situe l’avenir de la liberté. Nous ne sommes pas à la fin de l’histoire. Elle reste grand ouverte, comme l’histoire de la liberté. » (Marcel Gauchet)
Archivé dans la catégorie :
Vidéos et Sons